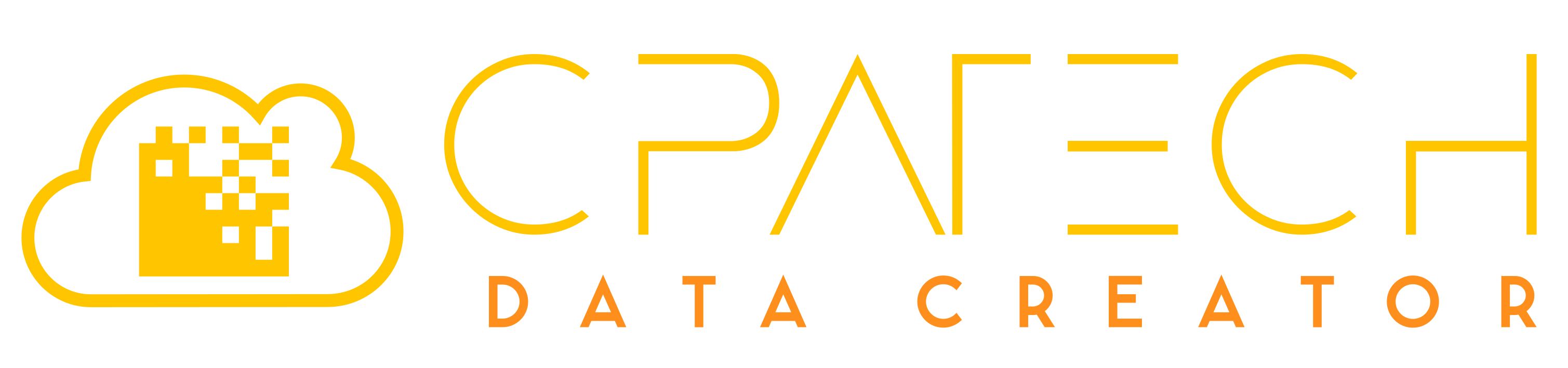Point mort
En complément au seuil de rentabilité, le point mort permet de déterminer le chiffre d’affaires nécessaire pour atteindre la rentabilité. Cet indicateur est essentiel pour gérer efficacement une entreprise. Que la société soit en démarrage, croissance, restructuration ou en reprise, le point mort fournit une direction claire pour le dirigeant. Il l’aide à prendre des décisions éclairées afin de faire progresser ses activités dans la bonne direction.
Qu’est-ce que le point mort en entreprise ?
Le point mort d’une entreprise désigne le moment à partir duquel une activité commence à être rentable en couvrant toutes ses charges. Il correspond au niveau d’activité minimum nécessaire pour générer un bénéfice. Exprimé en durée (jours, mois, années), il se distingue du seuil de rentabilité, qui est quantifié en volume de chiffre d’affaires ou en nombre d’unités vendues.
Quelle différence entre le point mort et le seuil de rentabilité ?
Le seuil de rentabilité représente le montant de chiffre d’affaires ou le nombre d’unités à vendre pour couvrir les charges. Le point mort, lui, indique le nombre de jours, mois ou années nécessaires pour atteindre ce seuil. À ne pas confondre avec le retour sur investissement (ROI), qui mesure la rentabilité des capitaux investis.
Avantages et inconvénients du point mort
Atouts
Le point mort est un outil décisionnel précieux pour les dirigeants, car il permet de :
- Fixer des objectifs commerciaux minimums pour couvrir les coûts fixes;
- Identifier le moment où l’entreprise deviendra rentable en cas de nouvelles structures ou marchés;
- Comprendre l’impact des charges fixes sur la rentabilité;
- Évaluer les effets des changements structurels sur les bénéfices.
Il peut être appliqué à différents niveaux : projets, types d’activités, produits ou marchés.
Limites
Cependant, le point mort reste un indicateur prévisionnel, sujet aux fluctuations des coûts d’achat et aux imprévus comme les pannes de machines. Il doit donc être recalculé régulièrement. De plus, il suppose que les charges variables augmentent avec le chiffre d’affaires, ce qui n’est pas toujours le cas, notamment pour les entreprises à forte saisonnalité.
Comment calculer le point mort de sa société ?
Exemple de calcul
Reprenons l’exemple provenant de l’article sur le seuil de rentabilité. Celle-ci a 1,7M$ de charges fixes et 1,3M$ de charges variables pour un total de 3M$, et, pour fin démonstration, le chiffre d’affaires annuel a été ajusté à 3,3M$.
Calcul du seuil de rentabilité
Seuil de rentabilité = Charges fixes / ((Chiffre d’affaires – Charges variables) / Chiffre d’affaires)
Dans notre exemple le seuil de rentabilité est à 2,8M$ (1,7M$ / ((3,3M$ – 1,3M$) / 3,3M$) = 2,8M$)
Calcul du point mort
Point mort = (Seuil de rentabilité / Chiffre d’affaires annuel) x 360
Dans notre exemple le point mort est de 305 jours (2,8M$ / 3,3M$ x 360 = 305 jours)
En résumé, au 305ième jour de l’année, l’entreprise commencera à produire des bénéfices. Si elle n’atteint pas le point mort avant la fin du 12ième mois, elle réalisera une perte. Si elle l’atteint sans le dépasser, elle atteindra l’équilibre dans ses résultats.
Charges fixes et variables : deux éléments incontournables dans le calcul du point mort
Charges fixes
Les charges fixes ou coûts indirects ne varient pas avec la production. Elles comprennent les frais généraux (abonnements, assurance, loyer, publicité) et les salaires indirects (admin, commerciaux, dirigeants…). De plus, a moins que les salaires opérationnels, dis directs, soient une rémunération à la pièce, ceux-ci devraient plutôt être considérés comme fixe.
Charges variables
Les charges variables ou directes évoluent selon la production de biens ou services. Elles incluent :
- Les coûts d’approvisionnement (matières premières, marchandises, frais de livraison).
- Les frais de production (énergie, carburant, salaires de production payés à la pièce).
Optimiser vos données à la prise de décision
CPATECH propose des solutions pour :
- Simplifier la répartition de vos coûts entre les fixes et les variables;
- Développer des modèles de comportement de coût pour fin de simulations;
- Calculer le coût de revient de produits et services;
- Produire une base de données pour vos rapports de gestion;
- S’assurer de la pérennité de votre modèle de coût de revient;
- Centraliser vos données pour fin de déploiement.
Découvrir les fonctionnalités du logiciel de coût revient GenE
Envie d’en savoir plus sur la solution complète de gestion des coûts et du coût de revient? Prenez rendez-vous avec un expert pour découvrir comment optimiser la gestion de votre rentabilité de votre entreprise.